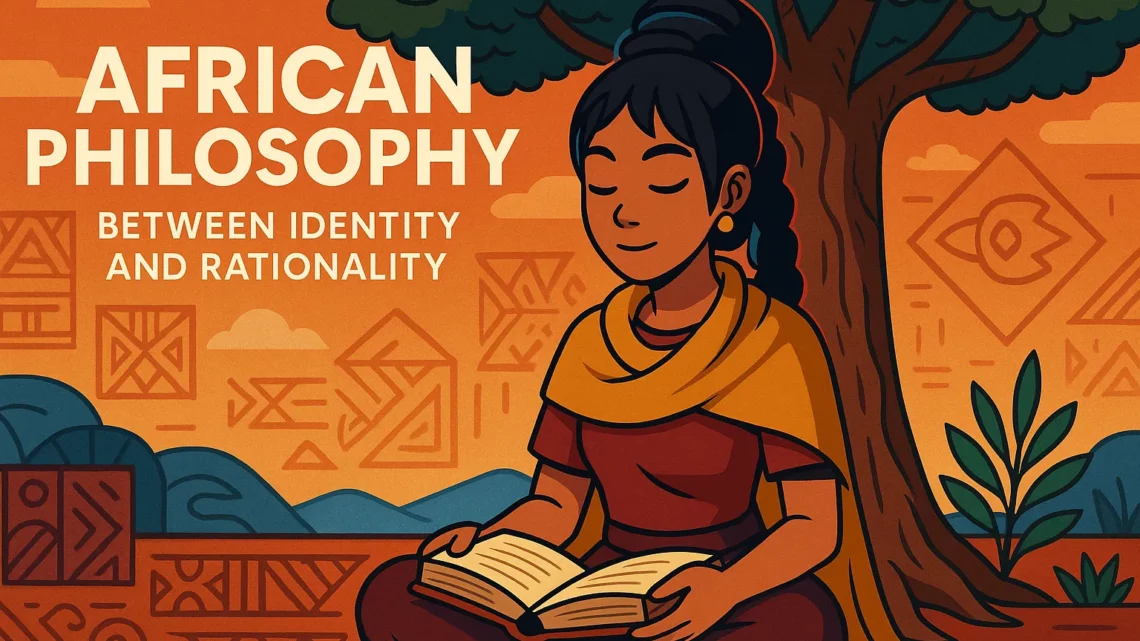La philosophie africaine: Entre identité et rationalité
10 mai 2025Entre identité et rationalité : controverse sur l’existence d’une philosophie africaine
Un débat sur l’existence d’une philosophie africaine occupe les intellectuels du continent et de ses diasporas depuis 1947. Aux tenants de la thèse d’une philosophie endogène, solidaire des cultures africaines, s’opposent ceux qui ne conçoivent la philosophie que rapportée aux critères de sa constitution comme discipline autonome, avec une histoire qui lui est propre et qui vient des Grecs, héritée par le monde occidental. Ce cas de « conflit de vérité » divise les « ethno-philosophes » et les « euro-philosophes », ainsi que se qualifient mutuellement leurs tenants. À partir d’observations menées dans deux classes terminales à Dakar, l’article propose d’observer comment, dans un cours de philosophie, ces « vérités en conflit » peuvent être présentées et soumises à des exercices de réflexion, par la discussion et la recherche de solutions de dépassement.
La question de l’existence d’une philosophie africaine est inscrite au programme sénégalais de l’enseignement de la philosophie en classe terminale des lycées. Elle constitue, tout compte fait, un cas d’espèce d’une problématique plus vaste et plus familière : celle d’identité – tant celle qu’on attribue aux Africains que celle qu’ils entendent se donner eux-mêmes. Ce débat sur la philosophie africaine est symptomatique d’enjeux idéologiques, culturels et politiques qui en constituent le soubassement.
Les élèves, même à ce stade d’initiation à la philosophie comme discipline enseignée, y sont donc préparés d’une certaine manière et confrontent des points de vue différents : cette identité est-elle une ou plurielle ? L’« africanisation » des programmes d’enseignement – après une longue période d’extraversion de ceux-ci – participe du souci d’amener les élèves à placer au cœur de leur réflexion et de leur formation les questions décisives de leur environnement culturel, physique et politique.
Les thèses en conflit
Au commencement, un livre : La Philosophie bantoue
L’auteur de La Philosophie bantoue est le Révérend Père Placide Tempels, missionnaire belge au Congo. L’ouvrage est traduit du néerlandais au français et publié en juillet 1948 par la maison d’édition Présence africaine, à Paris. Cet ouvrage part de l’idée qu’il y a, dans la culture bantoue, les linéaments d’une philosophie reconnaissable à quelques idées que le missionnaire se propose de recenser pour en faire une présentation cohérente :
Par les méthodes d’analyse et de synthèse de nos disciplines intellectuelles, nous pouvons donc et devons rendre aux « primitifs » le service de rechercher, classifier et systématiser les éléments de leur système ontologique.
Le livre de Tempels suscite, dès sa parution, de vives réactions. Léopold Sedar Senghor y voit une confirmation des thèses du mouvement de la Négritude : ensemble de valeurs culturelles du monde noir. Alioune Diop, fondateur de la maison d’édition Présence africaine, salue l’événement en ces termes :
Voici un livre essentiel au Noir, à sa prise de conscience, à sa soif de se situer par rapport à l’Europe.
Par contre, dans son Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire condamne l’argumentaire du missionnaire belge et accuse celui-ci d’avoir construit un système de justification de la colonisation et un moyen idéologique de persuasion pour l’évangélisation des Africains.
Ce débat, lancé donc dès la parution de l’ouvrage, demeurera en toile de fond de nombre de prises de position en matière de recherche sur les savoirs, les pratiques et les institutions africaines. Débat qui se ramènera à la question fondamentale suivante : les Africains étaient-ils (avant tout contact avec la civilisation occidentale) aptes à la spéculation dans sa forme particulière qu’on appelle philosophie ?
Invention du concept d’ethnophilosophie et arguments des contempteurs de celle-ci
Dans son Essai sur la problématique philosophique de l’Afrique actuelle (1971), le philosophe camerounais Marcien Towa utilise le concept d’ethnophilosophie pour décrire et fustiger cette démarche théorique consistant, selon lui, à assimiler la philosophie à n’importe quelle vision du monde. Il estime qu’il faut se détourner de la négritude senghorienne et de l’ethnophilosophie, cette dernière n’étant ni de l’ethnologie ni de la philosophie et, de ce fait, plaçant la problématique de la philosophie africaine dans une impasse.
Paulin Hountondji, philosophe béninois, insiste de son coté sur la nécessité « de clarifier un débat confus », entretenu par les tenants de l’ethnophilosophie, à qui il reproche, lui aussi, de procéder à des recherches reposant sur l’idée d’une vision du monde collective présentée comme philosophie collective, celle de tout un groupe, de tout un peuple.
Towa et Hountondji accusent, à leur tour, les tenants de cette « ethnophilosophie » (Tempels, Kagamé, entre autres) d’avoir construit une pensée destinée à servir de support à l’entreprise de colonisation et d’évangélisation des Africains par une meilleure connaissance de leur culture.
Aux yeux des contempteurs de « l’ethnophilosophie », la littérature d’intention philosophique reposant sur l’idée d’une vision du monde collective d’un peuple ou d’une culture est de l’ordre de l’implicite et apparaît à ses détracteurs comme hypothétique. En revanche, les textes écrits par des intellectuels qui se réclament de la philosophie sont de l’ordre de l’explicite et engagent leurs auteurs en tant qu’individus et sujets assumant leurs propres discours.
De l’avis des contempteurs de « l’ethnophilosophie », ne pas tenir compte de cette différence, c’est faire du concept de philosophie un fourre-tout et entretenir la confusion entre la spécificité d’une discipline et des pratiques n’ayant pas les mêmes principes ni les mêmes méthodes. L’une de ces formes de déviation et de confusion incriminées consiste à confondre culture et philosophie par une extension de la notion de philosophie à tous les domaines de la vie intellectuelle et pratique.
La riposte
Ceux qui sont accusés de pratiquer l’ethnophilosophie reprochent à leurs contempteurs d’être des eurocentristes. C’est ainsi qu’ils critiquent, par exemple, certains aspects du projet de Marcien Towa consistant à vouloir réorienter la philosophie africaine de manière à prendre pour modèle de sagesse celui indiqué par Bacon et Descartes de « rendre l’homme maître et possesseur de la nature ». Ou bien encore, dans cette même perspective, le choix fait par le philosophe camerounais de donner comme modèle à imiter la philosophie de Hegel seule à même, selon Towa, de satisfaire aux exigences épistémologiques et théoriques de cette discipline. La référence à Hegel, sous certains rapports, heurte les adversaires du philosophe camerounais.
Niamey Koffi, philosophe ivoirien, est l’un des porte-drapeaux de ces critiques de l’eurocentrisme. Ancien « marxisant », il a consacré sa thèse de doctorat de troisième cycle à une question relative à « la pensée africaine », intitulée L’Articulation logique de la pensée Akan-N’Zima (un groupe ethnolinguistique de Côte d’Ivoire).
Le projet que défend Niamkey Koffi, et qui lui vaut d’être classé parmi les tenants de l’ethnophilosophie au même titre que l’abbé Alexis Kagamé, par exemple, est celui-ci : constituer une philosophie qui, sans renier l’apport de l’Occident, des présocratiques à Karl Marx, prendrait appui sur le passé culturel africain. La philosophie et les philosophes africains ont pour tâche d’exhumer les pensées anciennes, traditionnelles ou archaïques de l’Afrique, de mener des travaux de recherche approfondie sur la culture africaine, notamment sur les langues africaines, domaine de prédilection susceptible de révéler un univers africain de pensée.
[…] Abdoulaye Elimane Kane
Abdoulaye Elimane Kane est professeur émérite de philosophie (Université Cheikh Anta Diop, Dakar). Son doctorat d’État (Lille, 1987) portait sur les systèmes de numération parlée des langues ouest-africaines. Il a exercé plusieurs responsabilités, en tant qu’inspecteur général de philosophie, chef du département de philosophie (1987-89), ministre de la communication et de la culture du Sénégal (1993-2000). Il est également romancier. Courriel : elkane31@hotmail.fr
Référence électronique
Abdoulaye Elimane Kane, « Entre identité et rationalité : controverse sur l’existence d’une philosophie africaine », Revue internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 77 | avril 2018, mis en ligne le 30 avril 2020, consulté le 11 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/ries/6156 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ries.6156
Bibliographie
ATTOLODE L.-B. (1986) : « Philosophie africaine : un nouveau visage », Revue sénégalaise de philosophie, n° 10, juillet-décembre, p. 111-114.
CESAIRE A. (1955) : Discours sur le colonialisme, Paris : Présence africaine, 4e édition.
DIAGNE R. (2009) : Philosophie, classe de terminale, Dakar : Michel Lafon/Maguilen.
DIOP A. (1965) : « Niam M’paya », in Tempels R.P., La philosophie bantoue, Paris : Présence africaine.
DIOP cheikh A. (1993) : Antériorité des civilisations nègres. Mythe ou vérité historique ? Paris : Présence africaine, 1967.
DIOP cheikh A. (1979) : Nations nègres et culture, Paris : Présence Africaine, 1954, 1964.
HOUNTONDJI P. (1981) : Sur la philosophie africaine, Paris : Maspero.
JANHEINZ J. (1958) : Muntu. L’homme africain et la culture négro-africaine, Paris : Seuil.
KAGAME abbé A. (1976) : La philosophie bantou comparée, Paris : Présence africaine.
KANE A. E. (1981) : « La philosophie et les cultures africaines », Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines, Dakar/UCAD, n° 11.
KOFFI N. (1974) : L’articulation logique dans la pensée Akan-N ‘Zima, thèse de 3e cycle, université Paris V.
MOUELLE E. N. (1998) : De la médiocrité à l’excellence. Essai sur la signification humaine du développement, Yaoundé : CLE, 3e édition.
NDAW A. (1966) : Peut-on parler d’une pensée africaine ? Paris : Présence africaine, n° 58, p 32-46.
DOI : 10.3917/presa.058.0032
SENGHOR L. S. (1964) : Liberté 1, Négritude et humanisme, Paris : Seuil.
SYLLA A. (1978) : La philosophie morale des Wolof, Dakar : Sankoré.
TEMPEL R. P. (1948) : La philosophie bantoue, Paris : Présence africaine.
THOMAS L. V. (1967) : « La mort et la sagesse africaine (Esquisse d’une anthropologie africaine) », Psychopathologie africaine, Bulletin de la société de psychopathologie et d’hygiène mentale de Dakar, vol. III, n° 1.
TOWA M. (1971) : Essai sur la problématique philosophique de l’Afrique actuelle, Yaoundé : CLE.